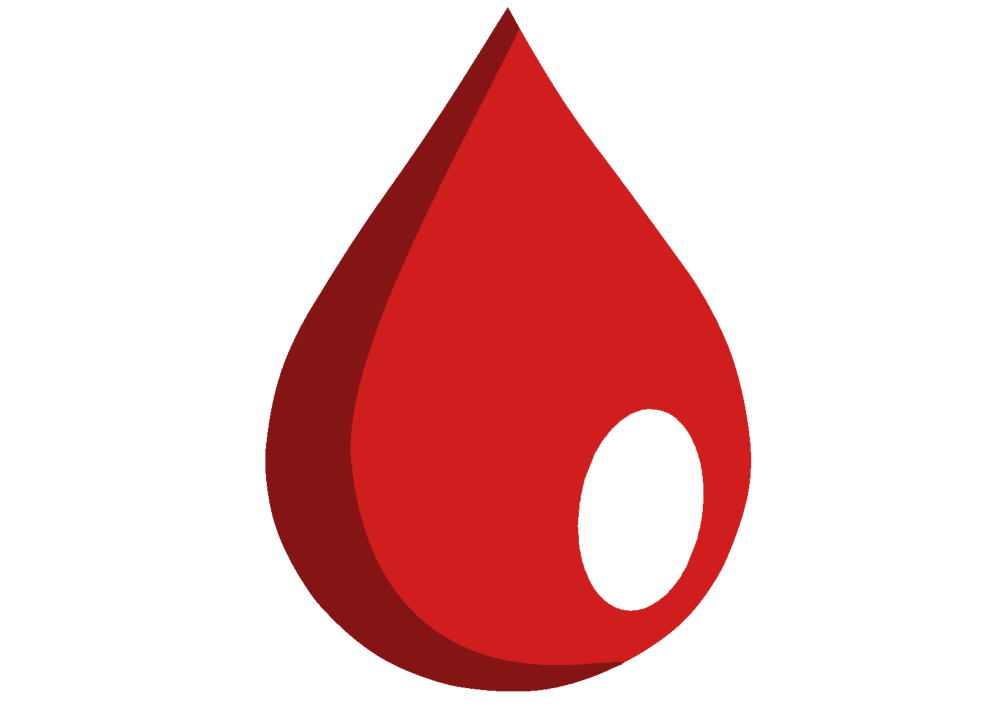Florence Vinit, Ph.D. est psychologue clinicienne et professeure au département de psychologie de l’UQAM. Elle travaille depuis plusieurs années sur le rapport au corps, dans une approche phénoménologique.
J’ai commencé ma quête autour du sang des femmes, forcée par un corps qui se tordait de douleurs chaque mois et auquel, au moins dans un premier temps, on ne proposait pas grand-chose. Lorsque je regardais autour de moi, j’étais abasourdie de voir des amies qui pouvaient presque oublier qu’elles avaient leurs menstruations, tant la chose était pour elle anodine. Y avait-il d’ailleurs une bonne façon de vivre ces menstruations ? Sur quels repères collectifs pouvais-je m’appuyer ? Très vite, j’allais m’apercevoir que le registre d’attitudes à l’égard ce qu’on appelle aujourd’hui « le sang des lunes » était terriblement limité.
Trop souvent les menstruations doivent se soumettre à être une forme de non-événement ne devant pas modifier le rythme habituel de la vie. Les règles s’annoncent entre nos jambes et nous sortons de manière automatique l’arsenal toujours prêt au fond du placard : nos serviettes hygiéniques, avec ou sans languettes, version de jour ou de nuit, pour flux léger, modéré ou important; nos tampons, avec ou sans applicateur, en plastique ou en carton. Nous les laissons absorber le flux bien sagement et les jetons dans les poubelles des toilettes sans plus nous en préoccuper.
Ainsi, pour beaucoup, les règles ne sont pas quelque chose de particulièrement intéressant : elles ont tout simplement lieu. Les publicités se vantent d’ailleurs de développer des produits toujours plus performants pour les oublier. Les « tartines » des débuts de mon adolescence, qui me donnaient la sensation de porter des couches-culottes, se sont transformées avec les années en bordures de plus en plus minces, prenant parfois la forme d’une culotte string élancée. Les tampons appellent aujourd’hui à une plus grande insouciance encore : faire qu’on ne remarque même plus le moment des règles et qu’elles se fondent dans les tâches successives du quotidien.
Autre possibilité à l’égard des règles, qui s’entremêle souvent à la première et qui a pu varier selon les époques : le sentiment de honte relié à ce moment du mois. Il se caractérise d’abord par un tabou autour des termes employés pour parler du sang menstruel.
Ma grand-mère en était un bel exemple : je la revois encore en train de me raconter le manque criant de produits de la vie courante durant la Seconde Guerre mondiale. Elle ne prononçait jamais le terme de serviettes hygiéniques et employait de nombreux détours pour les faire exister dans la conversation. Pour ma génération, qui a vu fleurir les produits d’hygiène féminine en tout genre, autant sur les écrans de télévision que sur les présentoirs des grandes surfaces, cette attitude peut paraître très surprenante. Pour autant elle a été le lot de nombreuses femmes jusqu’au milieu du XX ième siècle, maintenues dans l’ignorance de ce qui arrivait à leur corps. La comédienne et journaliste québécoise Janette Bertrand raconte dans son autobiographie, le choc qu’a représenté (en 1938), le moment où son corps de jeune fille s’est soudain mis à saigner :
Et puis un jour, j’ai treize ans, je m’en souviens comme si c’était hier, je reviens de l’école avec du sang dans ma culotte. Je le dis à Magella qui rougit et m’envoie à maman. Maman prend une guenille sur la pile des guenilles à épousseter et me dit de mettre ça dans le fond de ma culotte. Elle m’avertit que ce sang va revenir tous les mois, que c’est la punition des femmes. […] Je ne sais pas d’où vient ce sang ni ce qu’il représente. Je ne sais même pas comment nommer ce qui m’arrive. Je suis atteinte d’une maladie honteuse dont on parle tout bas. [1]
De nombreuses jeunes filles, nos grands-mères et arrière-grands-mères ont ainsi vécu l’apparition du sang entre leurs jambes avec un grand effroi, dans un climat d’incompréhension d’un phénomène auquel personne ne les avait préparées ou un sentiment de honte et de solitude, car elles n’osaient bien souvent en parler à personne. Le culte du secret à l’égard des règles régnait donc non seulement au sein de la famille, mais aussi dans la sphère sociale où il fallait absolument éviter d’en faire état. Ceci explique combien les objets utilisés pendant cette période du mois autant que l’expérience des menstruations en tant que telle devaient soigneusement être passés sous silence. La serviette jetable, inventée dès 1896 par Johnson et Johnson aux États-Unis, ne put d’ailleurs pas être mise en marché en raison du tabou entourant le phénomène des règles. Il fallut attendre 1921 pour qu’une compagnie concurrente récidive en créant les serviettes hygiéniques jetables autrement appelées « Kotek ». On pourrait répondre que la génération actuelle est sans doute plus informée que celle de nos grands-parents et arrière-grands-parents, mais la gêne n’a pas pour autant disparue. Marie Darrieussecq dans un roman qui aborde les préoccupations d’une adolescente [2], raconte des situations qui ne sont pas si éloignées des descriptions de Janette Bertrand. L’héroïne décrit sa panique à l’idée de laisser un tampon sale dans la poubelle de son nouveau chum ou même de lui avouer qu’elle est menstruée alors qu’il commence à la caresser.
C’est pourquoi il est important de poursuivre un travail de parole et de dialogue autour de ce moment universel que sont les menstruations. Pour les faire sortir de leur voile de silence, pour que les femmes se fassent entendre dans ce qu’elles vivent à ce moment du mois, pour que nous puissions partager ensemble et faire exister cette expérience qui concerne la moitié de l’humanité. Pour éviter de se demander comme le disait Amy Schumer dans Trainwreck : « Que se passe-t-il si je tire la chasse et qu’il y a un tampon qui reste au fond de la cuvette ? Et pas un tampon mignon, des derniers jours. Je parle d’un tampon genre scène de crime. »
Références
[1] ↑ Janette Bertrand, Ma vie en trois actes, 2004, Libre Expression.