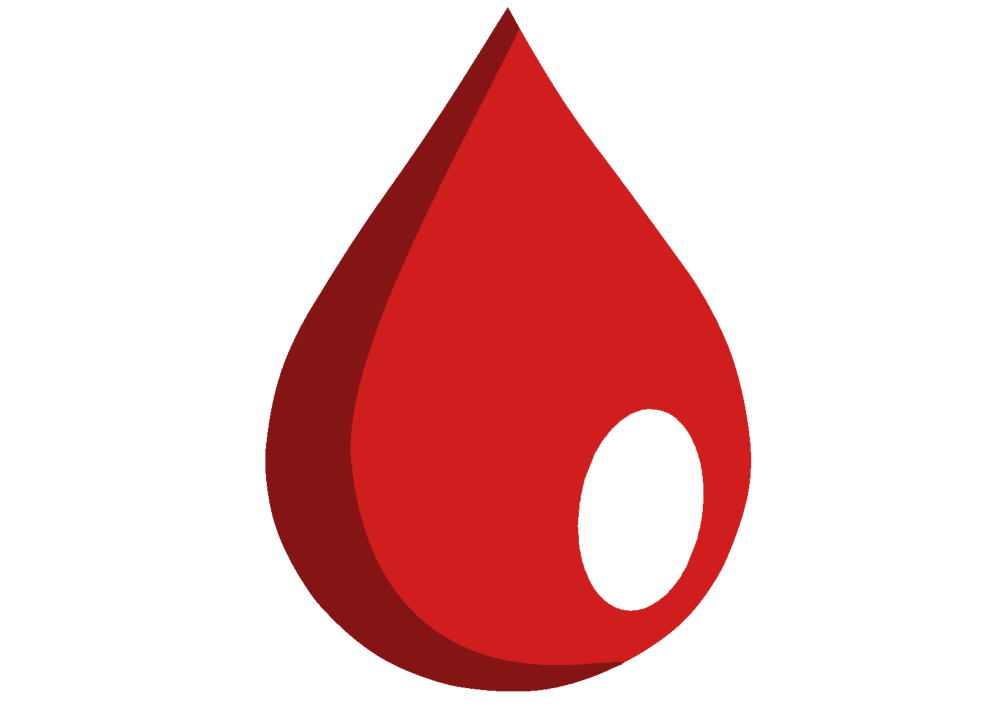Porter la vie et accoucher : normal !
Depuis que le monde est monde, les femmes portent des enfants et les accouchent. S’il devait y avoir quelque chose d’immuable en lequel elles peuvent avoir confiance, c’est bien leur capacité de donner la vie ! Pourtant, quelques décennies de reprise de l’accouchement par le corps médical scientifique ont suffi pour transformer cette expérience qui, maintenant, a majoritairement lieu à l’hôpital. En effet, si l’on s’intéresse à l’histoire, on constate la perte de droits des sages-femmes au fil du temps, au profit des médecins obstétriciens. Au Québec, les sages-femmes se sont battues corps et âme pour retrouver le droit de pratiquer des accouchements et leur marge de manœuvre est beaucoup plus grande ici qu’en France.
Cette transformation n’a pas été sans effet sur la confiance des femmes en leur corps, en leur intuition, en leur capacité de savoir ce qui est bon pour elles et le bébé qu’elles portent. Je vois également cela dans la peur que portent plusieurs de mes clientes envers les plantes médicinales (comme en fait foi le nombre faramineux d’avertissements « éviter pendant la grossesse » qu’on retrouve pour des plantes complètement inoffensives utilisées depuis des millénaires par les femmes enceintes).
La quantité de témoignages concernant la violence obstétricale, où les femmes subissent des mauvais traitements ou un manque de respect lors d’examens préliminaires et en salle d’accouchement[1], est frappante. Mon cœur se serre à chaque témoignage d’une cliente qui doit faire la paix avec un accouchement dans lequel elle s’est sentie dépossédée et démunie. Plan de naissance non respecté, insistance pour l’épidurale alors que la femme a clairement indiqué que cela ne faisait pas partie de ses plans, adaptation à un nouveau médecin obstétricien alors que le suivi a été fait par un autre, paroles blessantes alors que la femme est en posture de vulnérabilité… la liste est malheureusement trop longue. Ceci s’applique encore plus, malheureusement, aux femmes racisées et autochtones. Selon Hirut Melaku, il n’est pas rare que ces dernières subissent « des abus verbaux, de la discrimination raciale, des refus de soins et des violences médicales de la part du personnel médical[2] », comme on l’a vu dans la triste histoire de Joyce Echaquan. D’ailleurs, une étude menée à l’université Mc Gill montre que les naissances prématurées sont beaucoup plus élevées chez les femmes noires que chez les femmes blanches : 8,9 % comparé à 5,9 %, respectivement[3].
Le fait que la femme doive accoucher couchée et immobile – posture archaïque répandue, en dit long sur notre retard. Cette position dite gynécologique est pensée pour accommoder le médecin accoucheur et ses interventions. L’immobilité de la femme et la posture nuisent à la physiologie, à la gravité, aux mouvements du bassin qui peuvent faire gagner des millimètres d’espace au bébé qui négocie le passage étroit. La péridurale quant à elle peut faire en sorte, entre autres, que la femme ne reconnaisse plus les signaux naturels de son corps et compliquer ainsi tout le processus de l’accouchement. Lorsque l’accouchement est induit artificiellement alors que la femme n’est pas prête, il se termine souvent par une césarienne. Ainsi, à chaque fois que la physiologie est entravée, les interventions gagnent du terrain et deviennent souvent nécessaires (principe du pompier pyromane), pouvant mener à la césarienne par la force des choses. Sans dire que les interventions sont toujours négatives, nous avons du chemin à faire pour redonner le plein pouvoir à la femme dans la salle d’accouchement.
Dans son article États de siège[4], Philippe Ducros parle de la confusion qu’a créée l’étude pourtant bâclée « Term Breech Trial », qui concluait qu’il est moins risqué pour les bébés en siège de naître par césarienne que par voie vaginale. Cette unique étude a pourtant permis la remise en question du savoir millénaire sur ce type d’accouchements, les femmes en subissant directement les conséquences. En lisant le récit des deux accouchements de sa compagne, le premier avec de multiples interventions ayant mené à une césarienne et le deuxième, aussi en siège, au naturel, nous sommes à la fois choqué.e.s par les traumas que ces façons de faire androcentrées peuvent engendrer, et inspiré.e.s par le changement qui semble s’amorcer dans notre capacité à les remettre en question.
[1] https://www.erudit.org/fr/revues/rf/2018-v31-n1-rf03912/1050662ar/
[2] Dans Empreinte de résistance, Alexandra Pierre, éditions du Remue-Ménage, p. 223
[3] https://www.cmaj.ca/content/188/1/E19
[4] https://edition.atelier10.ca/nouveau-projet/magazine/nouveau-projet-19/etats-de-siege